Historique rétrospectif
Depuis un an et demi, mes accès dépressifs s'espacent. D'une moyenne approximative de deux par semaine, je n'en suis plus saisie qu'une fois toutes les deux ou trois semaines. Certaines fois je les traverse, avec l'envie orgueilleuse que mon corps se suffise à lui-même, ou qu'un acte d'endurance me rapproche de cette autonomie. Plus souvent je les garrotte, avec une dose réduite d'anxiolytique. Au moins ai-je cessé d'associer le recours médicamenteux à un échec.
Le fait d'avoir conscrit des accès dépressifs, depuis un état nominal de dépression diffuse, était déjà un progrès significatif. À l'origine, il y a l'introspection active menée avec le LSD entre 2015 et 2017. L'année suivante fut plus houleuse : j'avais suffisamment d'élan et d'intention pour commencer à contrer ma dysphorie, et explorer autre chose que l'allée socioprofessionnelle qui m'était suggérée, mais pas assez pour me protéger de la précarité induite. La rechute, désastreuse, fut certainement précipitée par les antiandrogènes de mon traitement hormonal initial.
J'ai retrouvé une modeste stabilité en 2019, en m'appuyant brièvement sur des microdoses puis sur un traitement antidépresseur suivi. Mon état s'est encore amélioré en me détachant d'une relation devenue dysfonctionnelle et en quittant à nouveau Paris, ce qui m'a permis l'an dernier d'initier une psychanalyse. Je n'ai pas poursuivi sur ce front en 2021, qui s'est surtout inscrite dans la triple attente d'une opération, de nouveaux papiers, et d'un logement. Pourtant, un trouble persiste.
Révision dénominative
Je n'ai que récemment pris conscience du fait que la mention d'un « accès dépressif » désigne généralement l'expérience d'un épisode prolongé de dépression, sur plusieurs mois ; une expérience bien distincte de celle que j'entendais, à savoir celle d'une crise subite, mesurée en heures. La formule est d'autant moins appropriée aujourd'hui, alors que les symptômes de la dépression (tristesse, apathie, abattement, troubles du sommeil, rumination, culpabilité...) ne s'exercent plus qu'avec une intensité réduite sur mon quotidien, quand ils n'en ont pas complètement disparu.
Seulement, l'équivoque n'était pas sans raison. Déjà parce que, lorsque j'ai commencé à identifier confusément ces crises il y a trois ans, la dépression était à ce point prégnante qu'il m'était impossible d'appréhender un phénomène subjectif en dehors d'elle-même. Ensuite parce que le caractère persistant de la dépression s'est dissipé petit à petit, sans adieu explicite ni définitif, et la continuité temporelle d'un trouble à l'autre m'a laissé croire qu'ils étaient identiques. Et enfin parce que ces crises portent des facteurs dépresseurs, qui se traduisent par un ralentissement psychomoteur et un sentiment d'impasse, parfois doublés de pleurs et de pensées suicidaires.
Repli paradoxal
Ces facteurs restent cependant loin d'englober l'expérience complète d'une crise, qui s'inscrit dans un cycle temporel assez marqué. Il y a d'abord, pendant un jour au moins, une accumulation diffuse de stress depuis diverses sources : interactions en groupe, trafic urbain, stimuli sonores multiples et désordonnés, situations inconnues et choix à prendre... Les signes sur mon corps sont minimes, et la situation est encore réversible, si je trouve une occasion de libérer ces tensions.
Autrement, le vase se remplit et chancèle. La pensée critique, celle au seuil de la crise, vient souvent d'une blessure que je ne parviens pas à vocaliser. Elle peut aussi bien prendre source dans une conversation que je voudrais immédiatement initier avec une personne proche, que dans une anecdote entendue depuis la pièce à côté et à peine corrélée. Le sentiment d'injustice face à un évènement lié à un ou une partenaire, présente ou passée, est un motif récurrent. Il est arrivé que je ne parvienne pas à comprendre mon émotion, mais c'est désormais l'exception plus que la norme.
Consciente ou non, la pensée se fait bloquante : je la repousse, je la relance, je la ronge, elle doit être expulsée ou bien m'engloutir. Je voudrais, je crois, savoir que je ne suis pas seule à la porter. Mais les obstacles à la communication sont multiples, qu'il s'agisse de la réticence à lancer une discussion désagréable avec une personne chère, de la gêne à pousser un sujet pénible dans une conversation de groupe, ou parfois simplement de l'absence d'interlocuteur... Il faut trahir le rôle, se montrer nue. Si j'y parviens, je gagne un sursis précieux. Sinon, le vase se renverse.
Viennent alors une montée, un plateau, une descente, qui se succèdent en l'espace de 12 à 24 heures. Pendant la montée, j'ai de plus en plus de mal à suivre les conversations, à interagir avec les gens autour de moi. Mon regard est fuyant, je me retranche à l'intérieur de ma tête. Le fil de conscience se dédouble, s'embrouille, je ne vocalise pas les dialogues que je projette, qui s'effacent de plus en plus devant les pensées que je ne m'adresse qu'à moi-même. Celles-ci perdent leur utilité, elles fusent, se consument, s'enchaînent et se bousculent avec une intensité croissante.
Au bout d'une heure ou moins, le plateau est atteint, la rupture est consommée. Dans les cas les plus extrêmes, c'est la catatonie : je me recroqueville, je ne parviens plus à bouger, je ferme les yeux ou bien mon regard est fixe et vide, et je ne réagis plus à rien. Plus souvent, j'ai pu m'isoler dans un endroit calme, m'abriter sous une couverture, et les symptômes de non-réactivité sont plus modérés. Je peux interpréter les questions qu'on me pose, appréhender la sollicitude autour de moi, mais je n'émets pas forcément de signe de réponse. Il arrive que je pleure un peu, plutôt en silence.
À l'intérieur par contre, c'est l'orage. Les pensées se chevauchent sans cohérence ; à peine une démarre que la suivante fait irruption et l'écrase. Savoir qu'il ne s'agit pas d'un état fonctionnel n'y change rien. Pendant une demi-heure environ, je me consume dans une frénésie de bribes. Ne me posez pas de questions ouvertes, parlez-moi le moins possible, n'ajoutez pas au chaos. En fait, le moment ne serait pas pénible sans la prévalence de pensées mélancoliques ou inquiètes, si fragmentées soient-elles. C'est là que se trouve la part dépressive dont je voudrais m'abstraire.
Parfois, je recherche une accroche physique : une main à tenir, un animal de compagnie à toucher, un objet à saisir. L'ancrage sensoriel retenu ne doit pas être une source supplémentaire de pensées, alors proposez éventuellement, mais n'imposez rien, et ne présagez de rien. Par le passé, j'ai reçu des aides qui rendaient la traversée moins pénible, et d'autres qui l'ont empirée. Gardez en tête que vos bonnes intentions ne se reportent pas directement sur mon bien-être (et ne culpabilisez pas si elles n'y suffisent pas). Cette distraction est la seule mise à distance que je connaisse ; autrement le flux de pensées est trop turbulent pour être contré par des techniques introspectives ou méditatives.
Il reste l'option de l'anxiolytique, qui précipite l'épuisement dans le sommeil. Reconnaître les signes de la crise permet d'y avoir recours pendant la montée, pour ne pas avoir à subir le plateau trop longtemps. Sans tranquillisant, les pensées finissent tout de même par se dissiper, me laissant faible et hagarde. C'est la descente, qui persiste parfois même après une nuit passée à dormir. La cacophonie intérieure s'est dissipée, mais communiquer me coûte plus que la normale, et le moindre son un peu élevé m'est vite pénible. Je suis généralement taciturne, maussade, fatiguée ; je me ménage et reste à l'écart de toute action, en attendant que se restaure un état plus robuste.
Monologue intérieur
Sans prétendre qu'il soit particulièrement remarquable, je voudrais maintenant soumettre à l'examen mon fil de pensée habituel, quotidien, et laisser se faire jour d'éventuels rapprochements avec les crises précédentes. Par « fil de pensée », j'entends principalement le monologue qui se déroule dans ma tête, les phrases qui se forment à mon seul entendement. Certaines personnes raisonnent plutôt par l'intermédiaire d'images abstraites que de mots ; je me place dans la seconde catégorie avec, il me semble, une prévalence croissante des mots au fil des années.
En fait, l'entreprise de présenter ce paysage mental depuis l'expérience immédiate me dépasse. Je laisse à d'autres le soin de structurer ces pensées innombrables et éparpillées. Mon approche est plus fonctionnelle, ou moins patiente : en m'appuyant sur mon jugement, je souhaite caractériser les aspects dysfonctionnels de ce monologue, donner les raisons qui me le rendent pénible.
- Une partie du monologue consiste à anticiper ce que je pourrais faire, planifier ce que je pourrais dire ou expliquer, souvent plusieurs jours à l'avance, mais les situations imaginées sont hypothétiques et bon nombre d'entre elles ne se réalisent jamais ;
- une autre partie consiste à rejouer des évènements déjà accomplis, avec ou sans considérations supplémentaires associées, qui m'éloignent d'une appréciation du présent ;
- une autre partie encore, est plus tournée vers les actions à mener d'une seconde à l'autre, mais s'accroche à des détails et met inutilement en question des choix élémentaires ;
- beaucoup de stimuli sensoriels (surtout sonores) sont reçus et considérés pour rien ;
- de façon transverse, le monologue va parfois trop vite pour que j'en tire quoi que ce soit ;
- il m'empêche régulièrement de m'endormir, et ce malgré la fatigue physique ;
- il rend plus difficile les interactions en groupe, qui exacerbent les souvenirs et les choix ;
- et il s'emballe particulièrement en ville, à cause du flux incessant de personnes que j'y croise.
La méthode la plus concluante que je connaisse pour calmer ces pensées en ville, c'est de me visser un casque sur les oreilles et de passer un album compatible avec mon état du moment. Les excitations sonores externes sont bloquées et mon attention est focalisée sur la musique. De même, en cas d'insomnie, lancer un film ou une série évite que dans les voix je ne me noie.
En fait, si je ne suis pas exposée à une musique ou des dialogues, il est rare que je n'aie pas quand même un morceau en tête. Mais alors celui-ci n'étouffe pas le monologue : il s'y superpose, s'enroule autour, passe imperceptiblement de la pleine conscience à l'oubli, comme un brin additionnel du fil de pensée. Et lorsque le morceau a des paroles, tôt ou tard j'y découvre souvent une phrase qui se rapporte à mon état émotionnel, ou au sujet que j'appréhende simultanément avec le monologue.
Ce monologue, je m'y identifie beaucoup moins qu'il y a quelques années. Je suppose qu'il s'est développé par l'introspection, qu'il a donné un corps rationnel à mes tendances dépressives, pour que je parvienne à les contredire et à les dissoudre. La dissociation a porté ses fruits : désormais, en dehors des crises de repli, je sais me mettre à distance des autocritiques dépréciatives. Je ne suis pas la voix elle-même, je suis son hôte ; je peux la juger en tort sans que cela revienne à me rejeter entièrement. Et j'aimerais bien, maintenant que la dépression paraît toucher à un dénouement, que les interprètes retournent sagement en coulisses au lieu de continuer à gesticuler sur scène.
Couplage autistique
En plusieurs points, ma description des crises de repli recoupe des symptômes autistiques, et plus spécifiquement ce que les anglophones désignent par autistic shutdowns. (À ma connaissance, la terminologie française relative à ce phénomène n'est pas arrêtée, le discours médical étant assez en retard.) Certains éléments de mon monologue intérieur, notamment l'hypersensitivité auditive et les difficultés de communication, sont aussi courammment cités parmi les troubles liés à l'autisme.
L'identification a ses usages et ses limites : elle guide l'acceptation de certaines idiosyncrasies en les éloignant d'une représentation purement pathologique, mais elle ne doit pas occulter les manifestations qui ne trouveraient pas leur place dans une hypothétique grille de lecture commune. J'appréhende l'étiquette de l'autisme, comme d'ailleurs celle des transidentités, non pas en tant que source de caractérisation rigoureuse, mais plutôt comme outil de partage d'expériences. Et bien qu'une comorbidité entre autisme et dépression soit avérée, je me garderai de croire ou de suggérer qu'un seul mot recèle toutes les réponses au malaise exposé précédemment.
Étant donc entendu que les frontières médicales du spectre autistique restent imprécises, et que les fluctuations qui peuvent être observées au sein des ressources ne valent pas d'être interprétées comme des incohérences, je relaie ici trois articles (en anglais) sur le phénomène du shutdown :
- From the Inside Out: An Autistic Shutdown, un témoignage personnel ;
- shutdown, une analyse empirique ;
- Shutdowns and Stress in Autism, une étude vulgarisée.
Réminiscences cohésives
Que des tiers attestent d'expériences comparables aux miennes : voilà qui me rassure, qui me rapproche d'une communauté et allège mon fardeau, mais qui ne m'empêche pas pour autant de continuer à douter de mes observations. La faute au dédoublement lié à la dépression, ou à une autre prédisposition cartésienne ? Le fait est que je me méfie que la manœuvre esthétique et morale que constitue l'écriture de cet article ne soit menée au détriment de la recherche de vérités inamovibles ; que l'arrangement des mots n'émerge indépendamment de celui des phénomènes.
Je n'ai pas de résolution métaphysique à portée de main, mais j'ai des souvenirs et des traces écrites, des quarts de preuve qui consolident mon récit et affermissent mon jugement. C'est en partie dans ces archives que je trouve l'espoir de formuler une compréhension correcte de ma situation psychologique, sur laquelle il me serait permis de construire des lendemains apaisés.
Premier extrait, tiré d'une critique de Black Swan, vu au cinéma en hiver 2011 :
Alors, mes mains, par la bizarrerie vite lassante des troubles psychosomatiques, ont décidé de jouer les paralysées. Mes doigts restaient bloqués dans une position vaguement agglutinée sans que je sois en mesure de les déplacer du moindre millimètre. Le souffle court, j'ai dit à mon copain et aux amis qui nous accompagnaient que j'allais prendre l'air sur l'esplanade de la Défense, en pensant que la situation allait rapidement se régulariser. J'ai filé dehors, un peu claudiquante, pour m'imprégner de l'air vivifiant de février. Je ne savais pas exactement de quoi rire, mais je l'ai fait, quand, ayant parcouru une moitié de la dalle, mes doigts toujours ankylosés étaient incapables d'actionner la glissière de mon portable pour répondre à mes amis qui commençaient à se poser des questions. Et puis finalement, peu à peu, au bout d'une heure, j'avais retrouvé jusqu'à l'usage préhensile de mon pouce. Je regagnais le haut de la chaîne alimentaire : j'étais sauvée.
Second extrait, tiré d'une rêverie sur la dune de Amanohashidate, au printemps 2017 :
Pourquoi ne peut-on se parler intérieurement qu'avec une seule voix ? Constat à modérer : Grimes me tourne en tête depuis un bon moment... même si, maintenant que j'y réfléchis activement, je ne suis plus capable de considérer le morceau que séquentiellement, par intervalles entrecoupés avec les segments de la pensée présente (celle que je matérialise par ces propres mots). Le mystère s'épaissit en considérant tous les processus inconscients qui peuvent s'activer dans l'ombre. Je n'entends qu'une voix intérieure, mais il n'est pas dit que ce soit la seule que j'émette.
Élucubrations métadiscursives
Parfois, je me prends à croire qu'il existe des réponses derrière l'acte d'affirmation, qu'il s'agisse de vocaliser une blessure, d'écrire un article comme celui-ci, ou de publier des photos. Les pensées se font moins obsédantes, ne serait-ce que pour un temps. Manifestement je souhaite transmettre, mais l'envie de prolonger chaque appel en un échange est moins évidente. Il joue sans doute dans cette assymétrie le fait que, pour moi, l'expression relève bien plus de la lutte que du plaisir, et qu'une fois atteint le soulagement anticipé, je m'empresse de réaiguiller ma volonté ailleurs.
En juin 2019, pendant quelques heures, à la suite d'une crise particulièrement incapacitante, j'ai exceptionnellement ressenti un étrange mélange de lucidité et d'euphorie. Le brouillard s'était levé ; les interactions étaient devenues faciles, évidentes, et j'étais libre d'exprimer l'ampleur de mes sentiments à chacune des personnes présentes ce soir-là. Il n'y avait plus de pensées à juger, évaluer, canaliser. Il n'y avait plus de constructions bâtardes, de témoins inoffensifs, de fragments aliénés. J'étais la seule dépositaire nécessaire de mon vécu, et enfin cela suffisait pour vivre.
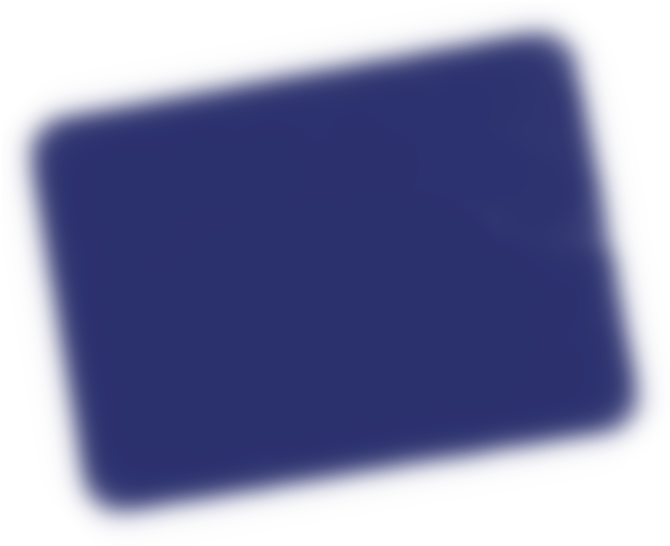

Versions archivées des liens externes présents dans cet article :