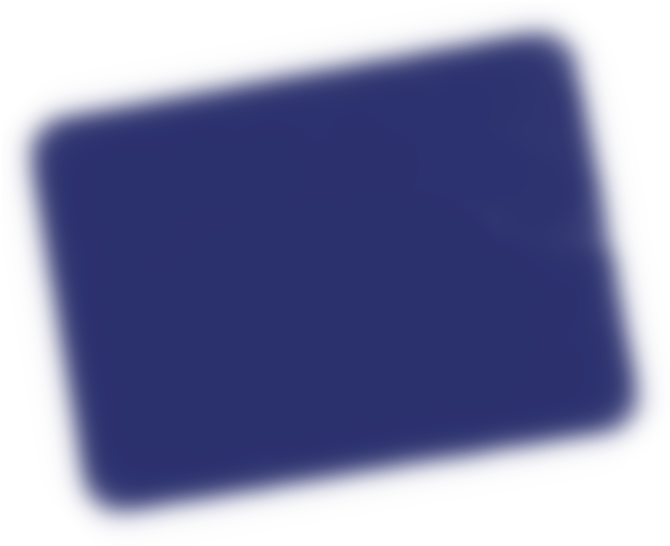Pour tenter de déjouer ma dépression, ma psychiatre m'a conseillé de prendre contact avec une psychologue, dont la démarche s'appuie sur des principes de psychanalyse. Je garderai ici une trace sommaire des cheminements de pensée et des avancées apparentes, d'abord pour tenter d'ancrer tout progrès en moi, mais aussi pour permettre, selon ce qui vous intéresse, d'appréhender mon parcours personnel ou bien la démarche générale.
Séance 1
Me voici chez A., qui reçoit à domicile dans le 13ème arrondissement de Paris. Elle m'invite à prendre place dans un fauteuil, et s'assoit en face de moi, de l'autre côté de la pièce, dos aux fenêtres. À sa demande, je fais le tour de la situation, de pourquoi j'ai pris rendez-vous avec elle. Plusieurs étapes reparcourues : le diagnostic d'autisme, la transidentité, les dynamiques de ma famille proche, le départ de mon travail, les voyages... Les épisodes les plus aigus de la dépression sont derrière moi, mais les envies suicidaires demeurent, inchangées depuis plusieurs années.
Je ne suis pas certaine de ce que la parole peut m'apporter, car je me considère déjà assez introspective, et je me perçois aussi comme étant plutôt ouverte auprès de ma famille et de mes ami·e·s. En tout cas, je n'entretiens pas de tabou sur mon état de santé, et cette honnêteté est la base du soutien régulier que je reçois de ma compagne et de ma mère.
On se jauge l'une l'autre. Je n'ai pas à me défendre de ce que je raconte. Je ne guette pas ses réactions, mais j'y suis attentive. C'est encore l'exposition. Elle approuve la formulation de mes doutes, présentés par le biais de l'impasse de ma première analyse fin 2018, auprès d'un psychiatre généralement réticent à répondre à mes questions. Je suis sceptique, mais je reviendrai.
Séance 2
Le doute m'a travaillée. Je comptais arriver chez A. en brandissant mes réserves sur le processus analytique, sa non-réfutabilité, son dogmatisme, et son hermétisme mystifiant. J'aurais ensuite concédé que je pourrais me contenter d'une thérapie empirique, sans base scientifique vérifiable, et donc que ces réserves montraient surtout que je ne cherchais pas nécessairement à me sentir mieux, ou en tout cas pas à remettre profondément en question mon état actuel. Ce sur quoi on aurait peut-être pu discuter, vu que c'est un dialogue avec moi-même que je repousse sans cesse.
Au lieu de ça, A. et moi nous sommes directement mises à discuter de choses et d'autres, en se laissant peu à peu guider par ce que trahissait le langage que j'utilisais, comme l'irruption soudaine du registre familier au milieu de ma langue formelle, par exemple. Une formule particulière reprise à l'identique à vingt minutes d'écart (« à côté de la plaque ») nous a amenées à nous interroger sur la possibilité d'un parallèle entre le décalage ressenti quand ma transidentité était latente, et mes réactions de repli autistique qui elles, quoiqu'occasionnelles, persistent à ce jour.
Contrairement à mon précédent psy, A. attrape les mots qu'il faut. Je sens qu'elle fait le travail de me pousser à faire face à ce que j'expose par le langage. Elle avait aussi retenu bien plus de ce que je lui avais raconté la semaine précédente, qu'elle prenne des notes extensives en post-mortem, ou qu'elle ait une excellente mémoire. Dans tous les cas, ni par l'attitude qu'elle affiche, ni par les méthodes auxquelles je me vois prendre part, je n'ai l'impression qu'on touche aux fumisteries de l'eros œdipien polymorphe. J'ai le sentiment qu'une bonne partie de mes réserves initiales serait assez hors-sujet à formuler. Ce serait comme partir dans une diatribe contre l'acupuncture auprès d'une kiné... Tout n'est pas rose, et je reste sur mes gardes, mais pour l'instant je m'engage.
Séance 3
Le début d'une séance avec A. est ouvertement libre. Je pourrais me laisser guider depuis un sujet trivial jusqu'à une observation profonde et pertinente, comme la semaine précédente, mais je décide cette fois plutôt de rebondir sur le « à côté de la plaque » qui avait été pointé du doigt, à juste titre. En l'occurrence, j'avais clairement entendu la répétition, avant même que A. ne la fasse remarquer. Cependant, l'admettre à voix haute m'a pris quelques secondes : il s'agissait d'une concession, d'une prise de guerre, qui reflétait le sentiment de m'être exposée, d'avoir trahi un moi intérieur. J'explique que cette pulsion défensive me ramène à l'idée qu'au fond, je ne chercherais pas à aller mieux. C'est une des manifestations de mon paradoxe cardinal : abriter fermement des envies suicidaires, et en même temps déployer des efforts manifestes vers une thérapie.
Nous laissons la réflexion en jachère, pour autant qu'il puisse y avoir une progression sur ce flanc. Il s'agirait en effet d'abord d'établir si l'envie de non-être est un symptôme ou bien une prémisse, et le problème me semble indécidable... À la place, A. propose de chercher à identifier l'inverse du sentiment de décalage évoqué au cours de la séance précédente. Autrement dit, les aspects d'une relation qui me font la valoriser. Je me prononce sans trop de peine, quoiqu'avec modestie compte tenu de ce que je sens se profiler à l'horizon, sur l'idée qu'une relation me paraît juste, qu'une connexion est établie à mes yeux, lorsque la personne avec qui j'interagis se montre vulnérable, qu'elle me fait part des obstacles qu'elle a surmontés, ou contre lesquels elle lutte présentement.
Sur le départ, j'écris un chèque pour dix euros de plus que le tarif dont A. et moi avions convenu (tarif déjà établi assez bas, eu égard à mes rentrées d'argent actuelles). J'explique précipitamment qu'il s'agit d'une « punition » que je m'impose pour avoir raté mon réveil et fait décaler la séance d'une demi-heure. Le mot la fait réagir, et je crois lire un souci sincère dans le mélange de pitié et de révolte qu'elle m'oppose. Je reformule en faisant valoir que cette écorchure financière est une façon d'ancrer la thérapie dans mes préoccupations intérieures et dans mon organisation du quotidien.
Séance 4
Le début de cette séance est plus laborieux que les précédents, j'arrive fatiguée après une nuit courte, et j'ai plus de mal à tracer une logique entre mes pensées embrouillées. Ma parole s'épuise et je tombe à deux ou trois reprises dans un puits d'où plus aucun mot ne prend forme. L'échange se resserre tant bien que mal autour de la part d'identité que j'associe à mes replis autistiques, de l'orgueil que j'éprouve envers cette anti-effusion sociale de ma personne.
Je mentionne ma découverte du LSD, ses apports introspectifs, et l'impression de pas avoir existé auparavant, de ne pas avoir été moi-même, tant que je n'avais pas commencé à prendre conscience des normes délétères selon lesquelles je me censurais. Contrairement au précédent psychiatre, tout juste capable de répéter un vieux mythe urbain qui trahissait sa méconnaissance grossière des psychédéliques, A. n'a nullement l'air déstabilisée. Je ne lis pas chez elle la surprise d'une révélation dramatique, mais le constat d'une pièce de puzzle supplémentaire, attitude évidemment plus féconde qui me met en confiance. Nous mettons fin à la séance après ma découverte fortuite du double-sens de « l'affirmation » : dans le contexte de la psychanalyse, ou en tout cas de la mienne, l'affirmation d'un soi est le pendant de l'affirmation langagière. Y aurait-il équivalence ?
Une digression sur les rêves, quel que soit le chemin qui m'y ait amenée. J'ai commencé à en garder trace il y a plusieurs années, et les rêves lucides me stimulaient à un degré primordial. Mais depuis près d'un an, plus d'architectures grandioses, plus d'aventures exaltantes. Le quotidien présente trop d'obstacles pour que mon esprit vagabonde, et les antidépresseurs ont aussi amoindri mon inventivité. Je tourne autour de motifs archétypaux, que la répétition a rendu anodins : transports, famille, maisons d'enfance, lycée, prépa. Je développe ce dernier point, car une évolution s'est progressivement opérée au cours des dernières années. En effet, d'élève victime de la violence du système (que je ne développerai pas ici), je suis devenue tour à tour détachée ou bien ouvertement rebelle et critique des cours ou des examens qui m'étaient imposés. Traçant un parallèle naturel, mais pas moins judicieux, avec notre évocation des normes quelques minutes plus tôt, A. fait l'hypothèse que ce rêve persiste, pas tant dans l'attente de la sublimation du formatage douloureux de cette période, mais surtout en tant qu'allégorie des systèmes contre lesquels je me suis dressée.
Séance 5
Je réanime sans attendre une observation que je m'étais faite deux semaines auparavant, à savoir qu'une relation « juste », qui s'appuie sur un partage de vulnérabilités, me permet de me sentir utile, par le biais des conseils ou du soutien émotionnel que je peux apporter. Sans cette dimension, sans rôle à remplir auprès de l'autre, la motivation ou le plaisir de l'échange m'échappent.
Cette position n'est pas sans écueil, et A. m'enjoint à en faire la critique. En premier lieu, ce que je vis comme une dialectique radicale, agir par le don de soi ou être dans le profit de l'autre, n'exclut pourtant pas la possibilité d'une position intermédiaire plus saine, dans laquelle je serais mieux en mesure d'exprimer ma sympathie et (surtout) mes griefs. D'autre part, bien que j'aie pu en faire un défi ludique auprès de nouvelles rencontres, au point de chercher à cerner quelqu'un sans me présenter en rien, j'admets que ce déséquilibre reste une source de frustration. Certes, l'aide aux autres pourrait être un accomplissement en soi, une finalité vers laquelle tendre. Mais je suis trop attachée à une conception autonome de moi-même, qui transcende le fait social. Dans un souci d'égalitarisme, ou peut-être d'hygiène logique, je souhaite poursuivre des objectifs qui ne reposent pas sur l'accomplissement, ni même sur l'existence, d'objectifs chez des personnes tierces.
En écho à la séance précédente, A. m'interroge sur le rôle du LSD dans ma conception des relations familiales. C'est en effet à la suite de mes premiers voyages intérieurs que j'ai pris conscience de mon envie d'entretenir plus de proximité avec ma famille. Avant ça, l'envie n'était pas là, ou du moins, je ne savais pas qu'elle était là. Ce que je retiens de mon éducation émotionnelle ne m'y portait pas : mon père se livrait extrêmement peu, et par réaction, ma mère s'épanchait en remarques passives-agressives. Le modèle que je poursuis serait donc à chercher ailleurs.
D'où qu'elle vienne, mon affirmation est positive. Il faut plutôt se recentrer sur les dynamiques déséquilibrées que j'entretiens. Peut-on leur trouver une origine ? Y a-t-il déjà des manifestations que je pourrais identifier, antérieures à mon expérience du LSD ? Je parcours mes souvenirs, à la recherche de dialogues marqués par une confiance qui m'était accordée. Je mentionne ma première relation amoureuse, ainsi que mon amitié principale au lycée, comme rares occurrences d'une ouverture réciproque, mais le rapprochement s'arrête là. Il me semble que j'arrivais à faire la part des choses... Je m'engage à parcourir de vieux messages, d'ici à la prochaine séance.